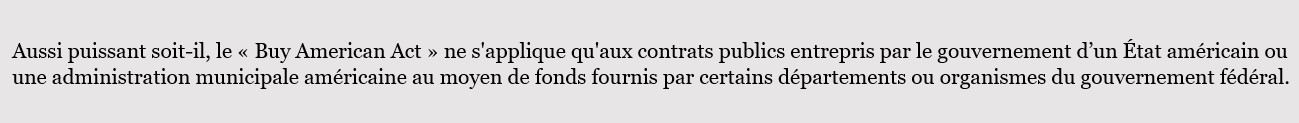Promouvoir les produits canadiens auprès des Canadiens n’est pas contraire à la lettre ni à l’esprit du libre-échange
Le thème du protectionnisme a dominé le récent sommet « Three Amigos » entre MM. Trudeau, Biden et Lopez Obrador à Washington, ce qui porte à se questionner sur les limites légales auxquelles le gouvernement du Canada doit se conformer pour promouvoir l’achat de produits « Bien fait ici » auprès des consommateurs et des entreprises d’ici sans contrarier ses deux alliés de l’Amérique du Nord.
 D’abord, il est à noter qu’il n’y a pas tant de différences entre les approches de Barack Obama, Donald Trump et Joe Biden sur le sujet, hormis que les tactiques de l’actuel président visent à avoir une incidence sur la lutte contre les changements climatiques.
D’abord, il est à noter qu’il n’y a pas tant de différences entre les approches de Barack Obama, Donald Trump et Joe Biden sur le sujet, hormis que les tactiques de l’actuel président visent à avoir une incidence sur la lutte contre les changements climatiques.
« Joe Biden est un partenaire plus prévisible, plus courtois et plus respectueux du multilatéralisme, mais il ne sera certainement pas moins protectionniste que Donald Trump », prévient Richard Ouellet, professeur de droit international à l’Université Laval.
Le nouveau décret présidentiel américain propose un réexamen complet de l’application du « Buy American Act », une loi datant de 1933 qui permet encore plus de favoriser les fournisseurs nationaux dans l’attribution des contrats publics.
Réagissant à la loi américaine qui engendrera un plan d’infrastructures de 1 200 milliards de dollars, où les fournisseurs « nationaux » seront nettement encouragés, M. Trudeau affirmait devant la presse que les principes du « Buy American » constituent « un défi particulier pas seulement pour les entreprises, les travailleurs ici au Canada, mais aussi pour ceux aux États-Unis, à cause de l’intégration de nos économies (…). Il est contre-productif pour les Américains d’amener plus de barrières et de limites au commerce entre nos deux pays ».

Rappelons que l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) remplace l’ALENA en vigueur depuis 1994 et que les échanges quotidiens entre le Canada et les États-Unis s’élèvent à quelque 2,5 milliards de dollars en biens et services.
En 2009, face à des menaces de protectionnisme, le gouvernement Harper avait négocié une dérogation de dernière minute avant que la loi entre en vigueur pour éviter un barrage de circonstances défavorables qui aurait mené à une issue que personne ne voulait déclencher, l’équivalent d’une guerre de représailles entres nos pays. La plus grande préoccupation à l’époque était l’instauration de mesures qui ne constituent pas en soi une application de tarifs illégaux mais, qui risquaient d’enfreindre les provisions des accords d’approvisionnement publics signés avec l’Organisation mondiale du commerce par le Canada, les États-Unis, l’Union Européenne et d’autres pays.
Nous ne sommes pas tout à fait de retour à la case de départ mais les reportages médiatiques indiquent qu’avec le retour au pouvoir des Démocrates, il a fallu recommencer la sensibilisation au fait que l’interdépendance des chaînes d’approvisionnement des trois pays liés par l’ACEUM est indéniable. Les économistes, les experts politiques et les élus cautionnent qu’actuellement il y a encore raison de se méfier.
Compter sur la forteresse économique nord-américaine pour défier la puissance croissante de la Chine pourrait aussi être un argument.
À ce propos, afin de tenter de contrer les velléités économiques nationalistes de Joe Biden, l’ex-ministre canadien des affaires étrangères François-Philippe Champagne avait lancé l’idée d’un « Buy North American Act » (« Achetez nord-américain ») par lequel on étendrait, à l’échelle du territoire nord-américain, le principe de l’achat local, y compris pour les marchés publics.
Revenons à notre question du jour: peut-on ou non inciter les Canadiens à acheter canadien?
Si on subventionne la production, si on subventionne l’achat de produits ou qu’on offre un crédit d’impôt aux acheteurs, on franchit alors une ligne délicate.
À titre d’exemples, le bois d’œuvre récolté en forêt publique au Canada, l’intention américaine d’offrir un crédit d’impôt applicable aux voitures fabriquées aux États-Unis, le contrôle de l’offre canadienne sur les œufs et les produits laitiers, voilà autant de filières pouvant aboutir à des litiges tranchés devant les tribunaux.
« Pour ces raisons, nous ne croyons pas habile de proposer au gouvernement canadien de subventionner ou d’offrir une quelconque forme de crédit fiscal, ni aux fabricants canadiens, ni à ceux qui les achèteraient », explique Richard Darveau, président-directeur général de « Bien fait ici ».
« Nous n’envisageons pas non plus de viser les marchés publics hautement surveillés dans le cadre de l’ACEUM, mais plutôt de stimuler les ventes auprès du secteur privé, c’est-à-dire les achats de matériaux et d’articles de quincaillerie effectués par les citoyens et les entrepreneurs en construction à leur centre de rénovation préféré », renchérit M. Darveau.
Les premiers avis juridiques que la permanence du programme « Bien fait ici » a requis ne semblent pas contenir de contre-indications lorsque l’action gouvernementale est indirecte, en se limitant par exemple à être annonceur publicitaire, voire commanditaire de campagnes d’information et de publicité sur les vertus d’acheter canadien pour le bâtiment résidentiel.
Pour éviter de choquer le puissant voisin, il faut prendre garde de ne pas ouvertement faire la pub sur son territoire, bien que l’étiquette « Bien fait ici » sera vu sur des produits faits au Canada lors de foires internationales, au même titre que l’on peut voir le drapeau américain sur nos tablettes ici.
En conclusion, le momentum en faveur de l’achat local et d’un meilleur contrôle de ses chaînes d’approvisionnement semble excellent et le terrain politique pour permettre au gouvernement Trudeau d’agir n’est ni plus, ni moins précaire qu’il l’était avant. La clé du succès, rappelons-le, est de faire valoir au pays les produits de qualité qui sont fabriqués au Canada.